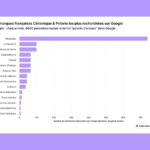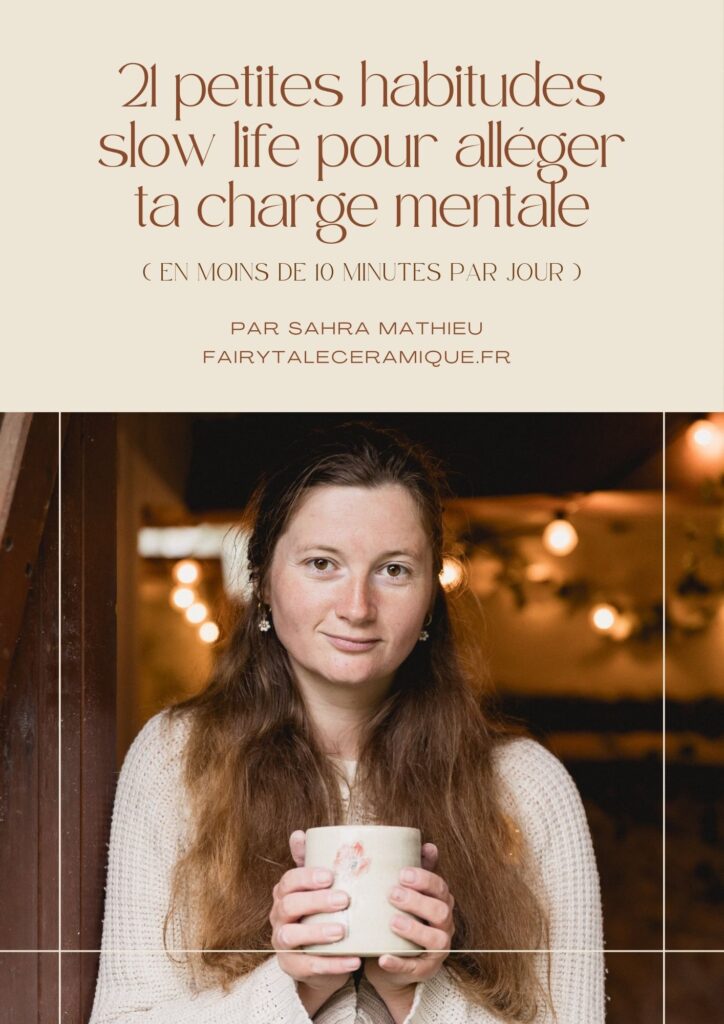Oui, tu as bien lu : 32 millions d’euros. Pour un bol. En céramique. Pas serti de diamants, pas en or massif, pas même un gadget technologique ultra-rare.
Juste (en apparence) un petit bol d’environ 13 centimètres de diamètre, vieux de près de mille ans, avec un délicat dégradé bleu-vert et une surface craquelée comme on en voit parfois sur… des assiettes Ikea (en moins antique, ok).
Et pourtant, ce bol Ru Guanyao de la dynastie Song du Nord, adjugé en 2017 par Sotheby’s à Hong Kong pour la modique somme de 32 millions d’euros (soit environ 37,68 millions de dollars), est à ce jour la pièce en céramique la plus chère jamais vendue.
Alors pourquoi ? Pourquoi ce bol précisément ? Pourquoi la céramique peut-elle valoir plus qu’un manoir ? Et comment une « simple poterie » peut devenir un objet de convoitise planétaire ?
On t’explique tout ça. Et tu risques de ne plus jamais regarder ton mug à café de la même manière.
Ce bol qui valait 32 millions : une tempête de valeur

Le bol Ru Guanyao, c’est l’élite de la porcelaine chinoise. Produite durant un court laps de temps (fin XIe-début XIIe siècle), dans une poignée de fours impériaux ultra-exclusifs, cette céramique était réservée à l’usage de la cour impériale.
Déjà rare à l’époque, elle est aujourd’hui quasi introuvable : seulement une poignée d’exemplaires subsistent dans des collections privées ou muséales. Bingo pour la rareté.
Mais ce n’est pas tout. Ce bol servait probablement à laver les pinceaux de calligraphie, une activité hautement spirituelle dans la Chine ancienne. Fonction symbolique + raffinement extrême + état quasi parfait = jackpot.
Ce qui fait la valeur d’une pièce en céramique (spoiler : ce n’est pas juste sa taille)

On pourrait croire que plus c’est grand, ancien ou joli, plus ça vaut. Mais la réalité est bien plus subtile.
Voici quelques facteurs clés qui expliquent pourquoi certaines pièces partent à plusieurs millions, pendant que d’autres stagnent à 20€ sur Leboncoin :
1. La rareté
On y revient toujours. Moins il y a de copies d’une pièce, plus sa valeur monte. Une série limitée d’un céramiste célèbre ?
Bim. Un four détruit à jamais ? Jackpot. Une technique oubliée ou impossible à reproduire aujourd’hui ? Bingo !
2. L’état de conservation
Un éclat minuscule, une fissure invisible à l’œil nu, et le prix peut chuter. Le Ru Guanyao, lui, est intact. Comme si les siècles n’avaient jamais existé.
3. L’origine et le contexte historique
Une poterie fabriquée pour un empereur ? Mieux. Pour un moine illuminé dans une grotte sacrée ? Encore mieux. L’histoire, l’aura, la provenance jouent énormément.
4. La technique et la complexité
Certains glaçages, comme le céladon Ru, demandent une maîtrise extrême et des conditions de cuisson quasi impossibles à reproduire. Une pièce peut ainsi devenir une performance technique unique.
5. Le nom derrière la pièce
Un vase signé Lucie Rie, Grayson Perry, ou Bernard Leach n’aura pas la même côte qu’un vase anonyme. Le facteur « célébrité » joue plein pot.
Et puis il y a… la valeur perçue
Voilà où ça devient philosophique. Car la valeur réelle d’un objet est souvent… une illusion collective. Ce bol chinois ne vaut 32 millions que parce que quelqu’un était prêt à les mettre.
La céramique, comme tout art, repose aussi sur des critères invisibles :
- Le prestige d’un objet
- Le fantasme autour d’une culture ou d’une époque
- La projection personnelle d’un collectionneur
- Le storytelling (l’histoire derrière l’objet)
C’est un peu comme l’amour : irrationnel, subjectif, intense.
Bonus : le Kintsugi, ou l’art de rendre l’imparfait précieux

Et si on te disait qu’une poterie cassée peut valoir plus qu’une intacte ?
C’est tout le principe du kintsugi, cette technique japonaise ancestrale qui consiste à réparer une pièce brisée avec de la laque saupoudrée de poudre d’or.
Plutôt que de masquer les fissures, le kintsugi les met en valeur, les sublime, en faisant de chaque cassure une partie unique de l’histoire de l’objet.
Résultat : un bol fêlé devient une œuvre d’art unique, un symbole de résilience, de transformation, de beauté imparfaite.
Et là, on touche à quelque chose de puissant :
La valeur ne réside pas toujours dans la perfection, mais dans l’histoire que porte un objet.
Dans un monde où le neuf règne en roi, le kintsugi invite à voir la fragilité comme une force, la réparation comme un enrichissement. Et mine de rien, cette philosophie influence aussi la perception (et donc la valeur) de certaines œuvres de céramique contemporaine.
Un bol réparé peut valoir des milliers. Pourquoi ? Parce qu’il raconte quelque chose. Parce qu’il touche. Parce qu’il est vivant.
Un objet, mille dimensions
- Psychologique : Acheter une pièce rare, c’est affirmer un statut, un goût, un pouvoir.
- Émotionnelle : Certains collectionneurs « ressentent » une pièce avant de l’acheter.
- Philosophique : Une poterie, c’est l’impermanence, le feu, la main humaine. Et dans certaines cultures, c’est presque une forme d’âme solidifiée.
- Économique : Un marché, des enchères, des fluctuations, des bulles spéculatives (oui, même pour les bols).
Et toi, comment savoir si ta poterie a de la valeur ?
Petit guide FTC pour devenir détective de la poterie :
- Est-elle signée ou identifiable ?
- Peux-tu retracer son origine ?
- Y a-t-il un style, une époque ou une technique reconnaissable ?
- Son état est-il impeccable ?
- Existe-t-elle en de multiples exemplaires ou est-elle unique ?
Spoiler : même si ta pièce ne vaut pas 32 millions, elle peut avoir une valeur symbolique, esthétique, émotionnelle ou artisanale immense. Et ça aussi, c’est précieux.
En résumé :
La céramique, c’est de l’or en terre cuite. Parfois littéralement. Et toujours passionnément. Le bol Ru Guanyao nous le rappelle : un objet minuscule peut contenir un monde de techniques, de mystères, d’histoire et de projections humaines.
Chez FTC, on adore ces histoires. Et si un jour tu croises un bol tout bleu-vert un peu craquelé… appelle-nous avant de le mettre au lave-vaisselle.
👉 Tu veux plus d’histoires de céramique folles, humaines et inspirantes ?
Abonne-toi à FTC Magazine — la poterie comme tu ne l’as jamais vue.
Sources :